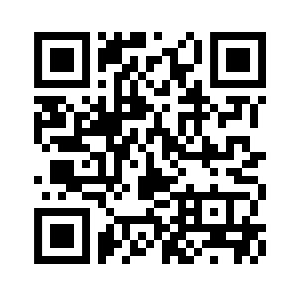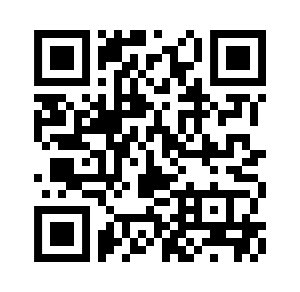Loi AGEC : quelles obligations pour les collectivités ?
9/24/20252 min temps de lecture


Introduction
Depuis son adoption en 2020, la loi Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire, plus connue sous le nom de loi AGEC, a profondément transformé les pratiques de consommation et de gestion des ressources. Pour les collectivités, elle représente bien plus qu’un cadre réglementaire. Elle impose une réorganisation concrète de la manière dont les équipements sont acquis, utilisés et valorisés. Cette loi, inscrite dans une dynamique de transition écologique, vise à réduire le gaspillage et à généraliser le réemploi, tout en incitant les acteurs publics à devenir des modèles de sobriété et d’efficacité.
Les objectifs de la loi AGEC
L’ambition de la loi AGEC est claire : sortir du modèle linéaire « produire, consommer, jeter » au profit d’une logique circulaire où les biens ont plusieurs vies. Pour les collectivités, cela signifie une révision de leurs politiques d’achat et de gestion des équipements afin de limiter le recours au neuf et de privilégier les produits issus du réemploi ou du recyclage. La loi fixe également des objectifs de réduction des déchets et de meilleure traçabilité des ressources, rendant indispensable l’adoption de nouvelles méthodes de suivi et de reporting.
Les obligations pour les collectivités
Concrètement, la loi AGEC impose aux collectivités d’intégrer une part minimale de biens issus du réemploi ou du recyclage dans leurs marchés publics. Les achats de mobilier, d’équipements informatiques ou encore de fournitures doivent inclure un pourcentage déterminé de produits de seconde vie. Les collectivités doivent aussi développer des solutions de traçabilité pour justifier auprès des autorités des efforts réalisés en matière de réemploi et de réduction des déchets. Enfin, elles doivent être en mesure de rendre compte régulièrement de leurs actions, à travers des indicateurs mesurables qui alimentent leurs rapports de durabilité et leurs bilans RSE.
L’impact organisationnel
La mise en conformité avec la loi AGEC implique souvent une transformation en profondeur. Les services d’achats, de logistique et de développement durable doivent travailler de concert pour établir des procédures communes. Les circuits internes d’acquisition et de gestion des équipements sont repensés pour inclure le don interne, la mutualisation ou encore la réparation. Cette évolution demande également une montée en compétence des équipes, qui doivent apprendre à gérer différemment les ressources disponibles et à collaborer avec de nouveaux partenaires, notamment les acteurs du réemploi et de l’économie circulaire.
Les bénéfices pour les collectivités
Si ces obligations peuvent paraître contraignantes, elles apportent aussi des bénéfices concrets. Les collectivités qui s’engagent dans cette démarche réalisent des économies en réduisant leurs achats neufs et en optimisant l’usage des biens déjà disponibles. Elles améliorent leur image en incarnant des pratiques exemplaires de responsabilité environnementale et sociale. Elles gagnent aussi en efficacité opérationnelle grâce à une meilleure organisation et à une gestion plus transparente des équipements.
Conclusion
La loi AGEC représente un tournant majeur pour les collectivités. Elle impose des obligations strictes, mais elle offre également l’opportunité de repenser la gestion des ressources à travers le prisme du réemploi et de l’économie circulaire. En adoptant une stratégie claire, en intégrant des outils de suivi adaptés et en impliquant leurs équipes, les collectivités peuvent non seulement respecter la réglementation, mais aussi devenir des acteurs exemplaires de la transition écologique. Donner une seconde vie aux équipements devient alors une évidence, à la fois pour préserver l’environnement et pour optimiser l’action publique.
DATA VALLEY
1000 L'OCCITANE
31670 LABEGE - FRANCE
RESEAUX SOCIAUX
SUIVEZ-NOUS SUR LINKEDIN!
CLIQUEZ OU SCANNEZ-MOI
© 2024. All rights reserved.